Entretien avec Nicolás Perrone à propos de l’ouvrage Investment Treaties and the Legal Imagination: How Foreign Investors Play By Their Own Rules (les traités d’investissement et l’imagination juridique : les investisseurs étrangers jouent selon leurs propres règles)
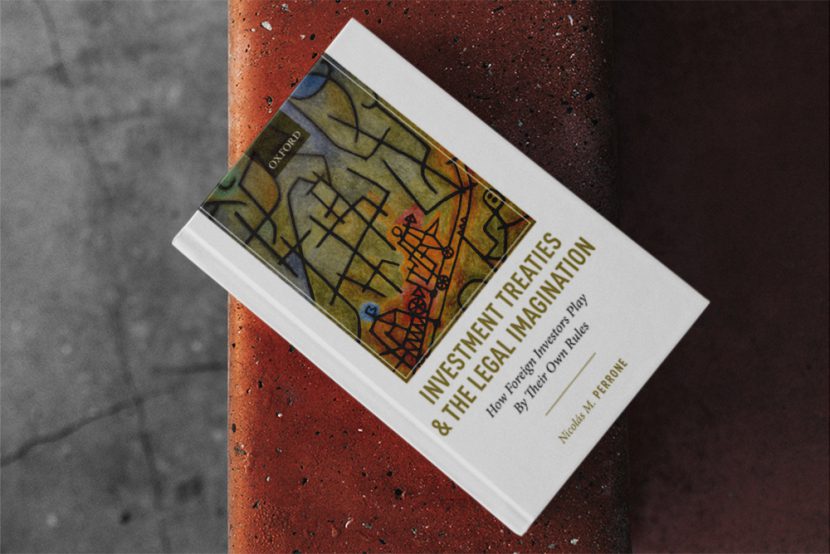
Investment Treaties and the Legal Imagination: How Foreign Investors Play By Their Own Rules (les traités d’investissement et l’imagination juridique : les investisseurs étrangers jouent selon leurs propres règles), l’ouvrage nouvellement paru de Nicolás Perrone sur le régime international des investissements, a été publié par Oxford University Press en avril 2021. Celui-ci nous pousse à réfléchir à la manière dont les origines du régime, c’est-à-dire les personnes qui l’ont imaginé et les circonstances dans lesquelles ils l’ont fait, façonnent la manière dont il fonctionne aujourd’hui. Plus important, il met en lumière l’étroitesse de cette vision fondatrice, qui pousse aujourd’hui les praticiens à ignorer les aspects principalement sociaux et politiques des relations investisseurs-État. Zoe Williams, l’éditrice d’ITN, s’est entretenue avec le professeur Perrone au sujet des idées centrales de cet ouvrage, et voici leur conversation, légèrement modifiée.
Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Quelles sont les lacunes dans nos connaissances du droit des investissements et du RDIE que vous cherchiez à combler ?
Le livre cherche à rassembler certaines des intuitions que j’entretiens depuis plus de dix ans.
D’abord, le débat autour du droit des traités d’investissement va au-delà des tensions entre les droits de l’investisseur étranger et le droit de l’État de réglementer. Le fait de limiter la discussion à ces questions présuppose que ces droits se définissent par eux-mêmes ou sont faciles à interpréter. Toutefois, en réalité, les droits de propriété et contractuels sont des éléments centraux de l’organisation sociale, et leur interprétation est chargée d’enjeux. La question n’est pas seulement de savoir comment équilibrer ces droits ; il faut aussi savoir ce que l’on cherche à équilibrer. Par ailleurs, les relations de l’investissement étranger ne concernent pas uniquement les investisseurs et les États ; il y a aussi les États d’origine, les élites nationales et les communautés locales. Dans une large mesure, les investisseurs et les États (ou les élites nationales) travaillent souvent de concert pour faire avancer un projet. Donc le postulat selon lequel il y a toujours des tensions entre les États et les investisseurs étrangers est erroné.
Ensuite, la pratique du RDIE n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat quelque peu attendu d’un projet d’acteurs multinationaux impliqués dans le secteur des ressources naturelles, notamment les investisseurs et leurs avocats. J’ai toujours EU des doutes quant à l’argument selon lequel le développement de la pratique du RDIE était imprévisible. En réalité, il existe une tendance interprétative remarquablement similaire qui remonte aux premières discussions sur les AII. C’est ce que j’appelle l’imagination juridique : la relation entre ces discussions juridiques et le projet de façonnement du monde de ces personnes. Abs, Shawcross[1], Royal Dutch Shell, la CCI, l’Association américaine du barreau (ABA) et d’autres ont défini le canon de l’imagination, et nous continuons d’opérer selon ce canon.
Le livre rassemble ces deux intuitions, faisant fond sur l’histoire, une analyse sociojuridique et la théorie juridique (le droit transnational, le droit de propriété), tout en essayant d’être fidèle à la pratique du RDIE et en représentant le domaine aussi honnêtement que possible.
Vous avancez que la situation actuelle du régime international des investissements repose sur « un méta-langage du droit international des investissements toujours influent à l’heure actuelle ». Quels sont les éléments fondamentaux de ce méta-langage ? En quoi est-ce important de comprendre le droit international des investissements de ce point de vue ?
C’est très important. Par imagination juridique, je veux dire que les entrepreneurs de la norme ont développé un vocabulaire spécifique, un méta-langage pour parler des relations de l’investissement étranger, et nous y sommes pris au piège. Évidemment ce vocabulaire n’est pas complètement nouveau ; les entrepreneurs de la norme ont fait fond sur les discussions de la fin du 19ème et début du 20ème siècles, les pratiques de l’empire légaliste des États-Unis et de ses investisseurs, et les principaux arbitrages internationaux de l’entre-deux-guerres.
Ce vocabulaire présente les relations de l’investissement étranger comme des transactions, plaçant les investisseurs et les États au même niveau, et normalisant la prémisse que les États accordent des mesures incitatives aux investisseurs, l’idée de risque politique et l’arbitrage comme voie de règlement des différends, et le fait que les AII peuvent attirer l’IDE. Mais les entrepreneurs de la norme n’ont jamais présenté de preuves empiriques en soutien de ces arguments, et certains des exemples d’actes gouvernementaux arbitraires qu’ils mettent en avant étaient en réalité des affaires où d’odieux investisseurs avaient payé des pots-de-vin et s’étaient immiscés dans les politiques nationales.
Rien de cela ne suggère que les États ne se conduisent jamais de manière arbitraire, mais l’essentiel des relations de l’investissement étranger montre que les investisseurs retirent des avantages et bénéficient d’un meilleur traitement que les investisseurs nationaux. Abs, Shawcross, et la CCI avaient pour objectif de convaincre les États d’offrir des mesures incitatives, de s’appuyer sur leurs ressources naturelles pour développer leurs économies, et d’oublier l’industrialisation. Les dons réglementaires (les mesures incitatives largement définies) sont tout aussi pertinents pour le droit des traités d’investissement que les saisies réglementaires, mais nous avons choisi de n’aborder que ces dernières.
Selon ce métalangage, la manière dont les États veillent à ce que l’investissement étranger bénéficie au pays d’accueil, la manière dont nous veillons à une distribution équitable des bénéfices, des coûts et des risques, ou la manière dont nous gérons les capacités asymétriques de négociation sont obscurcies, ou ne sont plus pertinentes. Il cache également les conséquences de ne pas avoir l’épuisement des voies de recours internes, l’importance des prescriptions de résultats. En outre, ce métalangage rend la communauté locale invisible, et représente le site de l’investissement comme une sorte de terra nullius où vous ne trouvez qu’un investisseur étranger et un État capable d’accorder des licences.
Votre histoire commence avec un groupe « d’entrepreneurs de la norme » dans les années 1950 et 1960. Quel était leur objectif ? Ont-ils obtenu ce qu’ils cherchaient ?
Ces entrepreneurs de la norme étaient un groupe de financiers, d’avocats et de dirigeants d’entreprises européens et étasuniens, qui ont tiré la sonnette d’alarme après les nationalisations en Iran, en Indonésie et en Égypte. Shawcross prétendait que les États ne pouvaient pas exproprier s’ils s’étaient engagés à ne pas le faire au titre de contrats de concession, et que les États pouvaient renoncer à leur droit régalien par le biais de ces contrats. Sur ce point, les entrepreneurs de la norme ont perdu.
Mais ils étaient également préoccupés par le fait que les pays du Sud mondial pouvaient invoquer la doctrine de la réparation partielle, développée par d’influents avocats internationaux pendant l’entre-deux-guerres. L’on nous dit que les pays d’Amérique latine ont rejeté la formule de la réparation prompte, adéquate et effective, et que les États-Unis et l’Europe insistaient pour l’inclure. La réalité c’est que les pays européens ont nationalisé des secteurs entiers après la Deuxième Guerre Mondiale. C’était un exemple dangereux pour les investisseurs qui craignaient que les pays du Sud mondial ne s’en inspirent, comme cela s’est produit, par exemple, avec la nationalisation du cuivre chilien. Sur ce point, les entrepreneurs de la norme ont eu gain de cause, et l’indemnisation dans la pratique du RDIE est généralement beaucoup plus élevée que dans les tribunaux nationaux.
Ils étaient également inquiets de la trop grande intervention des États dans l’économie. Ils ont donc défendu leurs notions juridiques d’expropriation indirecte et de protection des engagements (y compris la protection des attentes légitimes) pour discipliner ce type d’intervention. Cette manière de parler du droit des investissements est incroyablement proche de la pratique actuelle du RDIE.
Vous écrivez « La propriété peut être enracinée dans des organisations sociales, politiques et économiques qui ne coïncident pas nécessairement avec les États… Les notions de privé et public expriment les tensions entre les droits des investisseurs étrangers et le droit des États de réglementer, mais ne parviennent pas à distinguer les tensions à cet autre niveau ». Pouvez-vous expliquer l’importance du niveau « local » dans votre analyse, et, comme vous le mentionnez, la manière dont le régime conçoit la « bonne » et la « mauvaise » propriété ?
C’est là un point essentiel, et je pense que la littérature n’a pas prêté assez attention à l’enracinement. La tension privé-public n’est que l’une des dimensions de la situation dans les droits de propriété ou au titre d’un contrat. La tension mondial-local est une autre dimension pertinente. Comme pour la tension privé-public, il n’existe pas de définition ou de distinction claire, mais plutôt des arrangements qui ne sont jamais définitifs ou complètement pacifiques. Par le passé, j’ai fait l’erreur de parler des droits des investisseurs étrangers comme des droits sur les matières premières, comme s’ils n’étaient pas enracinés dans les relations sociales, mais ce n’est pas vrai. Les droits des investisseurs étrangers mettent en lumière les relations sociales transnationales au sein de l’entreprise, entre les entreprises, les élites capitalistes transnationales ou le marché mondial. Il y a donc un processus d’arrangement et de négociation entre les niveaux mondial, national et local. Les droits des investisseurs étrangers comportent toujours une dimension mondiale et locale, ainsi qu’une dimension privée et publique.
La dimension « mondial-local » est pertinente car elle nous permet de voir que, d’un point de vue formel, les droits peuvent être nationaux, tels qu’une licence environnementale, mais ils peuvent être enracinés dans le plan d’affaires de l’investisseur étranger. Ce genre de situation est pris en compte par le RDIE. Essentiellement, et je généralise ici, la tendance interprétative que nous trouvons est que le « mondial » est bon, et le « local » est mauvais. Le mondial représente le progrès, mérite d’être protégé et illustre quelque chose de raisonnable, tandis que le local est arriéré, arbitraire et ne devrait pas être protégé, ou devrait recevoir moins de protection. Dans le même temps, ce n’est jamais uniquement l’un ou l’autre ; la question à l’adresse des spécialistes du droit, également pertinente du point de vue de l’économie politique, est de définir cet équilibre et ses implications normatives.
Nous avons publié plusieurs articles sur les communautés locales et le RDIE[2], et ce que vous appelez « les communautés locales invisibles » dans le droit de l’investissement est une question qui attire davantage d’attention. Vous écrivez que cette invisibilité « repose sur le postulat que les États représentent les intérêts locaux lorsqu’ils traitent avec les investisseurs étrangers ». Pourquoi pensez-vous que ce postulat est erroné ?
L’argument de l’invisibilité repose non seulement sur le fait que les communautés locales n’ont pas qualité juridique dans le RDIE ou de droits au titre des AII. Il s’appuie également sur le fait que, ni le droit des traités d’investissement, ni la majeure partie de la littérature sur l’économie politique n’abordent leur rôle. Bien sûr, il existe des références aux communautés locales dans des travaux antérieurs. Je pense cependant que la situation a commencé à changer avec Lorenzo Cotulla et mes travaux, tous deux reposant sur une propriété heuristique, qui montre que les communautés locales ne sont pas entendues alors qu’elles sont au cœur des faits des affaires de RDIE.
Je pense que nous ne pouvons pas supposer que les États représentent les intérêts locaux. Le droit des traités d’investissement représente les relations entre les investisseurs étrangers et les États comme s’ils avaient toujours des difficultés à obtenir la meilleure répartition possible des bénéfices, des coûts et des risques. Toutefois, les affaires que j’analyse dans le livre montrent que ces relations sont parfois fondées sur une grande coopération. Ces gouvernements avaient fait avancer le projet et les intérêts des investisseurs jusqu’à ce que la situation n’entraîne des troubles sociaux ou une violence généralisée.
La littérature sur le développement montre que les coalitions qui favorisent les projets extractifs consistent généralement en des élites nationales de l’extraction, qui sont parfois des membres du gouvernement, et des investisseurs étrangers. Dans ce contexte, le fait d’assumer que les États sont du côté de la communauté et non pas de l’investisseur pourrait s’avérer empiriquement et normativement erroné. Les élites de l’extraction ont une vision différente pour leurs pays, c’est-à-dire pour le territoire et la population, que les communautés locales et les élites du développement.
Qui sont les « entrepreneurs de la norme » pertinents à l’heure actuelle ? Comment façonnent-ils les discussions en cours sur la réforme du régime ?
Dans la conclusion de l’ouvrage, je fais référence à un chapitre de David Schneiderman dans lequel il parle des entrepreneurs de la norme contemporains. Les intérêts en faveur du RDIE et des AII sont toujours présents ; l’extractivisme est important dans le Sud mondial. Dans le même temps, il est évident que l’ensemble de la communauté commerciale mondiale ne se soucie pas tellement de ce régime. Le RDIE convient parfaitement à ces investisseurs qui investissent dans des ressources immobiles, telles que les ressources naturelles ou les infrastructures.
Les ardents défenseurs des AII et du RDIE façonnent le régime de manière similaire aujourd’hui, reproduisant un canon de l’imagination où les investisseurs et les États sont les principaux acteurs, où le principal problème est le risque politique, où le droit international des investissements se réduit essentiellement aux droits des investisseurs étrangers et au RDIE. La principale différence entre les entrepreneurs de la norme précédents et ceux d’aujourd’hui est que bon nombre de ces derniers sont aussi des arbitres et interprètent le droit.
Il se peut que ces individus acceptent des modifications marginales qui semblent progressistes. Par exemple, dans les années 1970, John Blair (de Shell et de la CCI) défendait l’idée des obligations ou responsabilités volontaires. Aujourd’hui, il se peut que ceux qui défendent le RDIE acceptent que les communautés locales participent aux procédures ou même qu’elles présentent un recours contre les investisseurs. Encore une fois, cette position n’est pas contraire au canon de l’imagination, et en fait, elle avait même été envisagée dans les années 1960, comme je l’indique dans le livre.
Vous écrivez « Toutefois, une fois que l’on élargi la perspective pour se concentrer également sur les relations sociales créées entre les personnes par la propriété ou sur la manière dont les contrats affectent les tierces parties et une société donnée, l’autonomie et les attentes d’autres propriétaires et non-propriétaires ne peuvent plus être dissimulées ».
C’est une manière percutante d’exprimer à quel point notre compréhension traditionnelle des droits des investisseurs (et des obligations des États) est limitée, et toute réforme de notre approche de l’investissement étranger doit en tenir compte. Il se pourrait toutefois que cela ne relève pas de la portée du droit international de l’investissement (ou peut-être même du droit international). Je pense que la tendance de nombreux acteurs impliqués dans le processus de réforme (et d’autres travaux connexes sur les droits humains et les entreprises) consiste à ajouter des droits et obligations fondés sur le droit international pour les communautés et les entreprises, respectivement, afin de tenter de « ré-enraciner » le droit international. En 2018, IISD a organisé une réunion d’expert pour évaluer la question précisément.
Êtes-vous d’accord avec cette caractérisation et pensez-vous que l’approche est correcte ? Si non, que manque-t-il, et quelle alternative pouvons-nous envisager ?
Je pense que c’est tout à fait exact. Quand vous examinez ce point de plus près, vous avez l’intuition qu’il y a un problème. Si le problème vient du fait que les États ont cédé trop de souveraineté, est-ce que la solution consiste à leur demander d’en céder encore plus en internationalisant les obligations des investisseurs étrangers ? Les investisseurs étrangers devraient respecter le droit national, et les obligations devraient être définies et appliquées au niveau national.
S’agissant de la théorie juridique, le problème est que nous avons perturbé l’équilibre des droits et des obligations sur la base de suppositions souvent erronées, comme par exemple que les investisseurs étrangers auront tendance à être malmenés par les États. Les droits, les obligations et les privilèges sont tous liés les uns aux autres et constituent un système juridique. Si vous n’élevez que les droits des investisseurs étrangers et obtenez une tendance interprétative comme dans le RDIE (et aussi les États qui promeuvent en général les intérêts des investisseurs étrangers), les communautés locales n’ont guère d’autres options que de se tourner vers l’international ou le transnational. Elles doivent se mettre au niveau des investisseurs étrangers. En plus d’apparaître dans le livre, j’ai également approfondi ce point dans un chapitre récent intitulé International Investment Law as Transnational Law (Le droit international des investissements en tant que droit transnational).
Mais cette stratégie est risquée. Les défenseurs du RDIE considèrent qu’il s’agit d’une opportunité de consolider le régime juridique, comme Blair qui considérait qu’il s’agissait d’une opportunité de l’étendre dans les années 1970. Il était un ardent défenseur de la responsabilité sociale des entreprises. Si vous avez des obligations vagues ou volontaires pour les investisseurs étrangers, vous accroissez la légitimité du régime et renforcez les droits des investisseurs étrangers (car les obligations correspondantes sont plus faibles). Ces obligations seraient moins spécifiques qu’au titre du droit national, et les communautés locales n’auraient jamais la même représentation juridique que les investisseurs ou les États dans un contexte international. Les audiences auraient lieu loin des communautés, et les juges seraient probablement plus enracinés dans le « mondial » que dans le « local ».
Je pense à deux alternatives en particulier, qui remontent aux imaginations concurrentes des années 1970. La première consiste à réinstaurer l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Le travail des tribunaux de RDIE serait totalement différent s’ils disposaient d’une décision finale du judiciaire de l’État d’accueil. Les investisseurs étrangers feraient entre autres appliquer leurs droits dans la juridiction locale au regard de leurs obligations envers l’État et d’autres acteurs. Il se peut que la décision finale soit arbitraire, mais ils pourraient alors se tourner vers le RDIE. Dans ce scénario, la principale norme de protection serait le déni de justice. Il se peut bien sûr qu’il y ait des voies de recours directes en cas d’expropriation directe non indemnisée, mais en dehors de ça, rien de plus. Cette manière de gérer la situation tient compte des conclusions du Groupe de personnes éminentes des Nations Unies et la Charte des droits et devoirs économiques des États. Les défenseurs du RDIE ont caractérisé cette dernière comme une attaque directe contre l’entreprenariat privé. Pourtant, si vous lisez les opinions des rédacteurs de la charte, vous réalisez que la critique était de nature politique, et non pas technique.
L’autre alternative consiste à créer une organisation internationale où les États pourraient discuter des solutions aux problèmes généraux liés à l’investissement, tels que la Covid-19, et les coordonner, et aborder des questions ou différends spécifiques. Cette institution pourrait être dotée d’un mécanisme de règlement des différends (là encore, ouvert aux investisseurs après l’épuisement des voies de recours internes). L’avantage d’une telle organisation (comme une OMC de l’investissement) est que les États pourraient lancer des recours au nom des investisseurs étrangers, dans un contexte plus transparent. Les canaux diplomatiques sont obscurs et il est difficile de savoir ce qu’il se passe réellement. Donc, plutôt que de prétendre que nous allons dépolitiser les différends d’investissement comme Broches et Shihata l’ont fait, ce qui est impossible puisque l’investissement étranger est une question hautement politique, nous pourrions améliorer le niveau des discussions, les rendre plus transparentes, et convier davantage de parties prenantes à la table des négociations. Je peux imaginer les États discuter des droits et obligations des investisseurs étrangers dans un contexte comme celui-ci sans générer les problèmes que le RDIE créé, mais je ne pense pas que ce serait la panacée non plus.
Auteur
Nicolás M Perrone est un professeur associé de recherche en droit international à l’Université Andrés Bello, au Chili. Il est l’auteur de Investment Treaties and the Legal Imagination: How foreign investors play by their own rules (les traités d’investissement et l’imagination juridique : les investisseurs étrangers jouent selon leurs propres règles – Oxford University Press, 2021).
Notes
[1] Hermann Abs, directeur of Deutsche Bank, et Hartley Shawcross, conseil général de Royal Dutch Shell, ont coécrit le « Projet de convention Abs-Shawcross sur les investissements à l’étranger » en 1959, qui présentait les normes de la protection des investissements que nous retrouvons aujourd’hui dans des milliers d’AII.
[2] Cotula, L. (2021, mars 23) La refonte du droit de l’investissement à partir de la base : l’extractivisme, les droits humains et les traités d’investissement. Investment Treaty News. https://www.iisd.org/ITN/fr/2021/03/23/rethinking-investment-law-from-the-ground-up-extractivism-human-rights-and-investment-treaties-lorenzo-cotula ; et Sands, A. (2020, déc. 29). Le régime des traités d’investissement promeut-il une bonne gouvernance ? L’exemple de l’industrie minière à Santurbán, en Colombie. Investment Treaty News. https://www.iisd.org/itn/fr/2020/12/19/does-the-investment-treaty-regime-promote-good-governance-the-case-of-mining-in-santurban-colombia-anna-sands/

